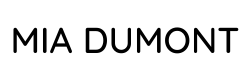Un article du DEVOIR signé Josée Blanchette que je reprends tant cela me parle…
Pour moi, ne rien faire, c’est bouger dans ma tête. Et vous?
Ne rien faire, la belle affaire

À retenir
-
- « Il y a ce qui nous manque : nos repères et des choses à faire : et, au bout d’un moment, il y a l’apaisement qui provient de ce manque. » – Christophe André, Méditer, jour après jour
- « Notre univers est trop pensé et pas assez rêvé. » – Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire
Les Méditerranéens ont perdu cette belle insouciance et se sont mis à l’heure de la productivité après avoir dynamité le fond de leur aquarium.
Bien égoïstement, vers qui se tourner pour réapprendre les heures longues, la vie courte et le pouls au ralenti ? Une discipline olympique, si j’en juge par le peu d’athlètes encore capables d’un tel exploit.
Les Japonais ont sûrement quelques moines en réserve susceptibles de nous enseigner l’immobilité. Mais j’en ai toujours pincé pour les Caribéens en terme de langueur, longueur, douceur de vivre et d’humeur à l’avenant. Munie d’un livre que l’« écrivain japonais » Dany Laferrière aurait dû publier au début de l’été plutôt qu’à l’automne, saison de tous les affairements, je me suis présentée l’autre après-midi à la nouvelle plage de l’Horloge.
Une pause à méditer
Dans L’art presque perdu de ne rien faire, l’auteur de Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer (je vous ai déjà mentionné que le biologiste Jean Lemire avait été accessoiriste dans ce film ? Le genre de détail qu’on omet dans un c.v.), « notre » écrivain haïtien nous offre une pause à méditer. Et le message ne serait pas aussi porteur si c’était un blanc-bec speedé aux smoothies vitaminés qui nous l’assenait.
Autrefois, on pouvait encore espérer bronzer idiot pour justifier cet arrêt sur image. Mais à l’heure où le cancer nous ronge tous les pores et après avoir expérimenté le mélanome d’assez près pour offrir des « peau-de-vin » à mon dermato, je recherche l’ombre et n’ai trouvé que le lendemain de cuite, cet état semi-comateux, ou la méditation pour me ralentir le manège.
Vous chantiez, j’en suis fort aise
Jean Charest l’a dit cette semaine : juillet est le temps de se reposer (de la politique) pour les Québécois. « Je crois de plus en plus que le monde est divisé entre ceux qui bougent sans cesse et ceux qui restent immobiles », écrit Dany dans le recueil de ses chroniques au micro estival de Franco Nuovo.
Sur cette plage de l’Horloge, si urbaine et si élégante, si design et si « carte postale », j’observais, en faisant semblant de lire Dany Laferrière, un Haïtien ne rien faire tout en surveillant sa petite fille jouer dans le sable blond, propre, filtré, ratissé et lissé. Je l’observais l’observer.
Lorsque l’élève est prêt, le maître apparaît. Mon gourou était là, sur mes genoux (merci Dany, quel plaisir de te lire ici, mon vieux) et devant moi, en chair et en noir, doué pour le « rien » du faire un après-midi de semaine.
Il y a des peuples plus équipés que d’autres et des moments plus propices au « rien » : l’après-midi, par exemple. Ou l’été. Et que dire du dimanche, un véritable cliché, mais au moins, on peut espérer qu’on nous fichera la paix sans trop d’explications. « C’est le septième jour ! Celui où Il se reposa. »
La différence entre « faire » et ne « rien faire » ressemble à la nuance entre dormir et somnoler, entre le lit et le hamac. Glander est un art presque perdu, même à la plage, où la plupart s’agrippent à leur téléphone comme à une bouée. Si Newton avait possédé un iPhone, il n’aurait probablement jamais remarqué la pomme qui venait de tomber.
Je suis repartie de cette plage avec la ferme intention de réapprendre à ne rien faire, moi qui étais si douée, il me semble, avant de devenir adulte et de confondre le temps avec une unité de production. Désormais, je ne me couche satisfaite qu’en regard de ce qui a été accompli, négligeant ma sérénité d’esprit comme on oublie de passer l’aspirateur au fond des garde-robes.
« J’ai peur des temps morts », m’a confié un ami cher, amoureux de la vitesse à ses heures. « Tu l’as dit, c’est le mot “ mort ” qui te fait peur », lui ai-je répondu. Car, bien sûr, « le temps pose de manière simple la question de la mort », écrit encore Laferrière. S’arrêter devant le « rien », devant le vide abyssal de notre état, c’est confronter sa propre mort et en mesurer la présence fidèle, jusqu’au bout. Tant qu’on s’agite dans le bocal, on s’imagine que le tourbillon de la vie nous distraira suffisamment du spectre. Mais c’est en s’arrêtant, curieusement, qu’on ne manque plus de temps, qu’il s’écoule lentement comme le sable dans le sablier, le sable de cette plage où je reviens doucement me couler.
Voler du temps
Comme on vole une sieste, il faut se tromper soi-même pour arriver à la neutralité et ne plus tromper l’ennui. Oh, la chose ne se fait pas brusquement. Il faut y mettre… le temps. Puiser dans une inertie insoupçonnée, fertiliser régulièrement, lui laisser la place, faire comme Hemingway qui prétendait que le plus difficile était de convaincre sa femme qu’il travaillait lorsqu’il regardait par la fenêtre. L’agitation est une preuve tangible qu’on vit encore. Et il y a tant à faire avant d’arriver au « rien » créatif.
Alors, je m’exerce à savourer les moments de torpeur béate, plages immobiles offertes par le diffuseur public (la vie) : après l’amour en observant les pales du ventilo au plafond ; au feu rouge, à dévorer des yeux ce motard low rider avec son casque melon, sa camisole blanche, sa cigarette au bec et son chihuahua aux goggles roses installé comme une sirène à la proue ; devant l’étang à traduire le coassement énigmatique des grenouilles. Chaque instant où j’accepte d’arrêter les aiguilles folles m’offre un cadeau, malgré toutes les voix intérieures qu’il me faut taire.
Et, là, tout de suite, je viens d’entendre une petite voix : « Je m’ennuie, maman, qu’est-ce que je peux faire ? » Rien, chéri. Viens, je vais te montrer. Au début, on ne sait pas comment. Après, on ne sait plus comment s’en passer.